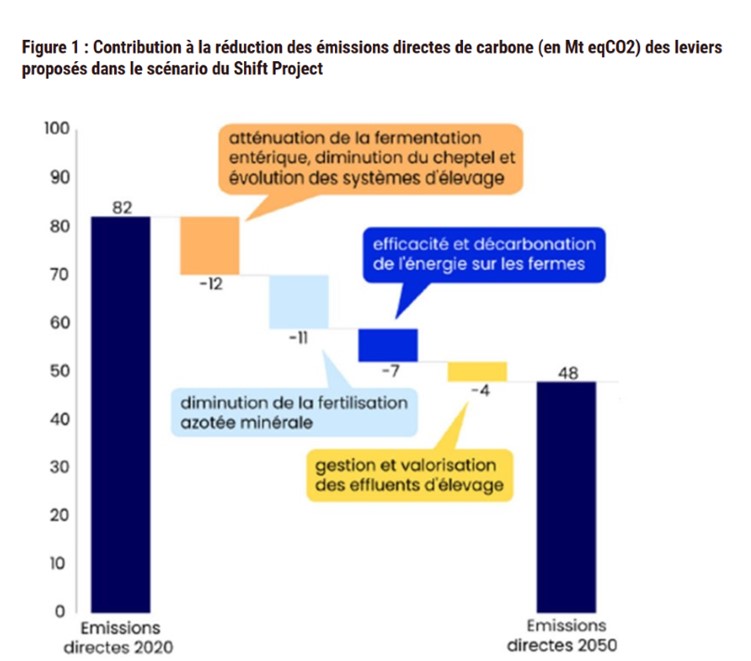Changement climatique
La séquestration du carbone dans les sols viticoles
Août 2025
Alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et impactent les rendements des cultures, le stockage de carbone dans les sols agricoles est une composante de l’équation complexe de l’atténuation du changement climatique. Bonne nouvelle : ce stockage de carbone a des bénéfices plus directs sur le sol et la culture car il correspond à une augmentation du taux de matière organique du sol.
La séquestration du carbone dans les sols agricoles fait partie des actions à mettre en place pour compenser les émissions de gaz à effet de serre que l’on ne pourra pas réduire.
Le stockage de carbone dans le sol est issu de la photosynthèse : la plante absorbe du CO2 atmosphérique dont le carbone devient un composant de la matière végétale. Lorsque celle-ci meurt, elle tombe au sol et est dégradée par les micro-organismes. Une partie va être rejetée dans l’atmosphère, l’autre sera transformée en matière organique. Quand cette matière organique est stable, son stockage (et donc celui du carbone) dans le sol sera long.
Vous l’avez compris, stocker du carbone dans le sol, c’est augmenter son taux de matière organique. Augmenter le taux de matière organique d’un sol, c’est apporter des bénéfices au sol et aux cultures :
- Amélioration de la structure du sol,
- Amélioration de la rétention en eau
- Réduction de l’érosion,
- Amélioration de la biodiversité du sol,
- Restitution plus importante d’éléments nutritifs aux cultures
Le stockage de carbone dans le sol n’est donc pas seulement un objectif environnemental, c’est aussi un objectif agronomique.
On peut se dire que les sols viticoles contribueront peu au stockage de carbone au regard de la surface de vigne présente en France aujourd’hui (et encore plus demain !). C’est vrai mais les sols viticoles sont globalement pauvres en matière organique et offrent ainsi un potentiel d’amélioration élevé. Effectivement, la vigne restitue peu de résidus végétaux au sol. Elle est souvent en place sur des sols pauvres en matière organique car elles les valorisent bien. Les sols viticoles manquent également d’un entretien de leur matière organique.
Quels sont les leviers pour augmenter le stock de matière organique des sols viticoles ?
Toutes les pratiques qui permettent d’apporter de la matière organique au sol directement ou indirectement :
- Les bois de taille doivent être restitués au sol. 2 tonnes de bois de taille par hectare permettent d’apporter 340 kg de matière organique stable au sol.
- Couvrir les sols. De manière permanente ou temporaire (engrais verts), les couverts végétaux, en produisant de la biomasse qui meurt et se décompose, apportent du carbone au sol. 2 tonnes de biomasse permettent d’apporter en moyenne 110 kg de matière organique stable au sol. Cette quantité varie en fonction des espèces présentes dans le couvert et de l’époque de destruction.
- Apporter directement des amendements organiques. La quantité de carbone apporté au sol et sa stabilité dans le temps vont dépendre de la quantité d’amendement apporté et de sa composition (C/N, ISMO).
D’autres pratiques encore confidentielles (vitiforesterie, biochar), nécessitent encore l’acquisition de références pour évaluer le potentiel de stockage de carbone associé.
Atténuer le changement climatique. Derrière cet enjeu qui semble inatteignable, il faut bien voir que les pratiques à mettre en place auront des bénéfices plus directs pour les sols et la vigne. Il faudra également plusieurs années pour les atteindre mais ils semblent plus à portée de main que le changement climatique.
Sources : https://www.vignevin.com/article/sequestration-du-carbone-dans-les-sols-viticoles/
Le projet 4 pour 1000
Stocker du carbone dans le sol pour compenser les émissions de CO2 dans l’atmosphère, tel est l’objet du projet 4 pour 1000 lancé en 2015 lors de la Conférence de Paris sur le Climat. L’idée de base est simple : si l’on augmente chaque année de 4 ‰ le stock de C des sols de la planète dans l’horizon de surface (0-30 cm), on compense nos émissions de CO2 et on atténue le changement climatique. L’INRA vient de publier les résultats d’une étude sur le potentiel de stockage en France et son coût.
Le label bas-carbone
Le label bas-carbone, mis en place par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, sert à labelliser des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et séquestration du carbone. Il permet un financement des projets par des entreprises, des collectivités, des particuliers en garantissant à ces financeurs la qualité du projet.
La contribution des cultures intermédiaires au stockage du carbone
Les cultures intermédiaires ont été préconisées à la base pour servir d’engrais vert et limiter les fuites de nitrates vers les nappes phréatiques. A l’heure du changement climatique, l’agriculture est émettrice de gaz à effet de serre mais elle contribue également à réduire les émissions de ces gaz en stockant du carbone dans les sols. Les cultures intermédiaires sont une pratique favorable au stockage de carbone dans le sol.
Haies et changement climatique
L’agriculture subit les conséquences du changement climatique (sécheresse, fortes précipitations, températures élevées…). Limiter les impacts de ce changement va dépendre de la capacité des systèmes cultivés à supporter les évènements climatiques extrêmes et de notre capacité à stocker du carbone. Dans ces 2 cas, les haies ont un rôle à jouer.
Quelles pratiques pour combiner lutte contre le réchauffement climatique et qualité de l’eau?
En France, l’agriculture est responsable de 19% des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES). Si l’agriculture est émettrice de GES, elle a l’intérêt de pouvoir également stocker du carbone et donc de compenser une partie des émissions de CO2. Que ce soit pour limiter le réchauffement climatique ou agir pour la qualité de l’eau, un seul objectif : réduire les pertes en carbone et azote.